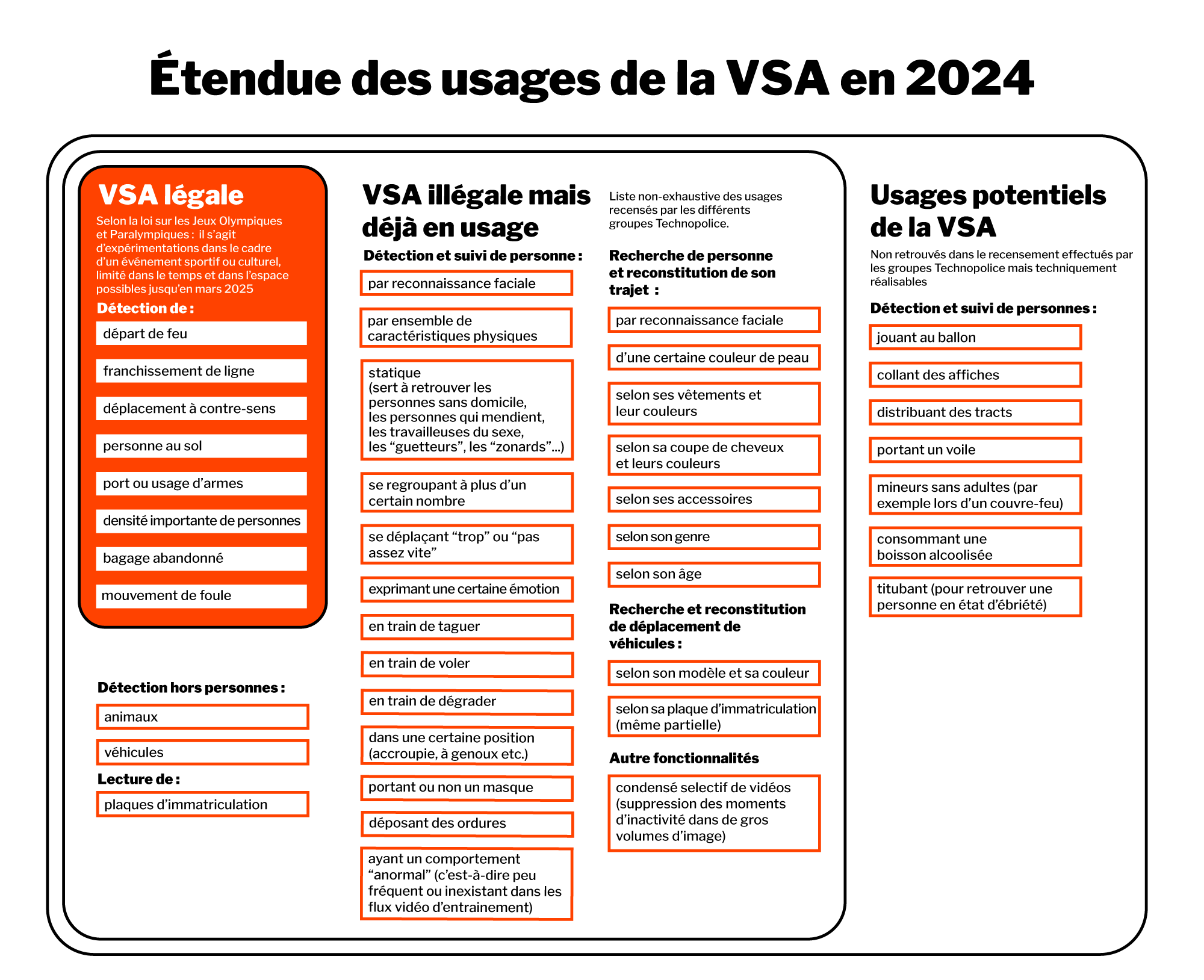Les Jeux Olympiques viennent de débuter, la surveillance et la répression y sont reines. En vue de cet évènement, l’État a mis en œuvre tous les pouvoirs sécuritaires accumulés ces dernières années : drones, QR code, périmètres de sécurité, vidéosurveillance algorithmique, assignations à résidence, présence policière intense, hélicoptères… De façon inédite, l’ensemble de ces moyens sont employés en même temps et à une échelle très importante. Au gré de cet emballement répressif, une autre mesure exceptionnelle mérite l’attention : l’utilisation hors norme des fichiers de police pour écarter des emplois liés aux JO les personnes ayant des activités militantes. Une forme de discrimination fondée sur des critères opaques et proprement inacceptable.
Fouiller le passé au nom de la sécurité
En France, l’accumulation d’informations sur la population à travers le fichage est une pratique ancienne et énormément utilisée par la police et le renseignement. Mais depuis une vingtaine d’années le nombre de fichiers a explosé, tout comme le périmètre des informations collectées et des personnes visées. En parallèle, leurs usages ont été largement facilités, avec peu de contrôle, tandis que leur légitimité est de moins en moins contestée dans la sphère politique et médiatique. Rappelons – au cas où cela aurait été oublié – que dans une logique démocratique, l’État n’a pas à connaître ce que fait ou pense sa population et que ce n’est que par exception qu’il peut garder en mémoire certaines informations concernant les faits et gestes d’individus. Cependant, et nous l’observons malheureusement pour toute forme de surveillance, ces principes théoriques sont écartés au nom de la sécurité et de « l’utilité ». Toute information disponible peut dès lors être conservée de façon préventive, peu importe la proportionnalité, la nécessité ou le fait que cela transforme chaque personne exposant des informations personnelles en potentiel suspect. Avec les Jeux Olympiques, nous avons aujourd’hui un exemple d’où cette démesure, couplée à une criminalisation croissante du militantisme, mène.
En 2016, la loi relative à la procédure pénale a créé la notion de « grand évènement ». Définie par l’article L.211-11-1 du code de la sécurité intérieure, elle recouvre des évènements exposés « par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste». Lorsqu’un rassemblement est désigné comme tel par décret, toute personne y travaillant de près ou loin (technicien·ne, bénévole, soignant·e, agent·e de sécurité…) doit alors faire l’objet d’une enquête administrative. À la suite de cette enquête, le « service national des enquêtes administratives de sécurité » (SNEAS) créé en 2017 délivre un avis désormais contraignant. S’il est défavorable, la personne ne pourra alors pas se rendre et travailler sur l’évènement.
Si des sommets géopolitiques ont été qualifiés de « grand évènement », c’est également le cas pour le Festival de Cannes, la Route du Rhum ou la Fête du citron à Menton. Dès 2021, les Jeux Olympiques 2024 ont ainsi été désignés comme « grand évènement », englobant par là l’ensemble des infrastructures, sites et animations associés aux Jeux. Cela a donc impliqué que des enquêtes soient effectuées sur un nombre immense de personnes, à la fois les équipes et délégations sportives mais également toute personne devant travailler autour de cet évènement. S’agissant des Jeux Olympiques, le 17 juillet dernier, le ministre de l’intérieur annonçait que 870 000 enquêtes avaient été menées conduisant à écarter « 3 922 personnes susceptibles de constituer une menace sur la sécurité de l’événement ». Gérald Darmanin se targuait ainsi que « 131 personnes fichées S » et « 167 personnes fichées à l’ultragauche » s’étaient vu refuser leur accréditation. Mais derrière cet effet d’annonce, il y a une réalité, celle d’une surveillance massive et de choix arbitraires opérés en toute opacité.
Une interconnexion massive de fichiers
Concrètement, les agents du SNEAS interrogent un système dénommé « ACCReD », créé en 2017 et qui interconnecte désormais 14 fichiers. Le système ACCReD a été créé pour faciliter ce que l’on appelle les « enquêtes administratives de sécurité ». Ce type d’enquête est encadré par l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure. Originellement prévu pour le recrutement d’emplois dans les secteurs sensibles, elle est aujourd’hui utilisée pour un spectre bien plus large, dont l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et la délivrance des titres de séjour. La CNIL exigeait ainsi en 2019 que soit précisé le périmètre de ces enquêtes, d’autant qu’elles « conditionnent l’adoption de décisions administratives nombreuses, très diverses et ne présentant pas toutes le même degré de sensibilité1Voir la Délibération CNIL n°2019-06, 11 juillet 2019, portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n°2017- 1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD), accessible ici ».
ACCReD interroge de nombreux fichiers2Voir la liste complète à l’article R.211-32 du code de la sécurité intérieure aux périmètres et objets très différents. Parmi eux on retrouve le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui rassemble les informations de toute personne ayant eu affaire à la police, même si celle-ci n’a pas fait l’objet de poursuite ou a été ensuite relaxée. Les personnes interpellées à l’occasion de manifestations ou d’actions politiques sont donc dans le TAJ. Contenant environ 20 millions de fiches, le TAJ est un véritable fourre-tout comprenant de nombreuses données incorrectes. Dans un rapport de 2019, des députés pourtant de droite dénonçaient même le dévoiement de sa finalité première « pour se rapprocher du rôle du casier judiciaire » et que « le fait que le TAJ contienne de nombreuses informations inexactes (erreurs diverses, absence de prise en compte de suites judiciaires favorables par l’effacement des données ou l’ajout d’une mention) [puisse] en effet avoir des conséquences extrêmement lourdes pour les personnes concernées par une enquête administrative. 3Didier Paris, Pierre Morel-À-L’Huissier, Rapport d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, 17 octobre 2018, page 58, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1335_rapport-information.pdf»
Il y a également le fichier des personnes recherchées (FPR) contenant les célèbres fiches S compilées de manière discrétionnaire par la police, le fichier des données relatives aux objets et véhicules volés ou signalés ainsi que le fichier d’information Schengen sur les personnes recherchées dans l’Union européenne. Mais ACCReD interroge aussi d’autres fichiers de renseignement politique comme le PASP et le GIPASP, contestés il y a quelques années en justice pour leur champ extrêmement large : opinions politiques, état de santé, activités sur les réseaux sociaux ou encore convictions religieuses… Ces fichiers ayant malgré tout été validés par le Conseil d’État, la police et la gendarmerie sont donc autorisées à collecter de nombreuses informations sur les personnes « dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ». Cette définition large et floue permet en pratique de cibler de nombreuses personnes, et notamment des militant·es.
D’autres fichiers de renseignements sont interrogés mais ceux-ci sont classés secret-défense ou font l’objet de décrets non publiés, ce qui signifie qu’il est impossible de savoir précisément ce qu’ils contiennent et qui y a accès4L’ article 1er du décret n°2007-914 du 15 mai 2007 liste l’ensemble des fichiers de renseignement qui ne font pas l’objet de publication. Il en est ainsi du fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), du fichier CRISTINA, (pour « centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux ») du fichier GESTEREXT (« Gestion du terrorisme et des extrémistes à potentialité violente ») géré par la Direction du renseignement de la Préfecture de Police de Paris (DRPP). Depuis fin 2023, l’extrait B2 du casier judiciaire, deux fichiers d’Interpol ainsi que deux fichiers de renseignement non publiés ont fait leur entrée dans ACCReD, en l’occurrence le fichier SIRCID (système d’information du renseignement de contre-ingérence de la défense) et le fichier TREX de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Pour en savoir plus sur l’ensemble de ces fichiers, vous pouvez trouver des informations dans la brochure « La folle volonté de tout contrôler », qui propose également des modèles de courriers pour demander à accéder à ses données et faire supprimer des fiches.
On le comprend, à travers la consultation de ces fichiers – aussi appelé « criblage » – le SNEAS a accès a une montagne d’informations. Si le nom de la personne apparaît dans un ou plusieurs de ces fichiers, l’agent du service doit, en théorie, évaluer à partir des informations accessibles si son comportement ou ses agissements « sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ». Si tel est le cas, il délivre un avis défavorable que l’organisateur de l’évènement est obligé de suivre et doit donc refuser d’employer la personne. Mais en pratique, il n’existe aucune information sur la manière dont cette évaluation est faite ni sur les critères utilisés pour évaluer un tel « risque ». Cette appréciation se fait donc de manière opaque et arbitraire, sur la base d’une définition large et floue, et la motivation du rejet ne sera jamais communiquée.
De plus, la loi précise bien que les enquêtes administratives ne peuvent pas concerner les spectateur·ices des grands évènements. Pourtant, le préfet de police Laurent Nuñez a affirmé lors d’une conférence de presse le 25 avril dernier que la préfecture avait « la possibilité de faire un certain nombre d’enquêtes » sur les spectateur·ices de la cérémonie d’ouverture. Le média AEF indique ainsi que l’entourage de Darmanin a évoqué « un criblage par la Direction du renseignement de la Préfecture de police (DRPP) de toute personne dont on pense sérieusement qu’elle présente un problème ». En effet, puisque les spectateur·ices étaient obligé·es de s’inscrire sur une plateforme, il était possible de récupérer leurs noms et de faire une enquête via des moyens détournés. En l’occurrence, la DRPP est un service de renseignement dit du « second cercle », qui dispose de nombreuses attributions, parmi lesquelles la consultation de fichiers identiques à ceux présents dans dans le système ACCReD. Ainsi, l’article R234-4 du code de la sécurité intérieure lui permet de consulter le fichier TAJ et l’article R236-16 l’autorise à accéder au PASP, c’est à dire les deux fichiers susceptibles de contenir des informations sur les activités politiques. Au nom des Jeux Olympiques, l’État et la préfecture de police contournent la loi et jouent avec le droit pour étendre toujours plus leur contrôle.
Une discrimination politique inédite
Alors que ce « criblage » a concerné des centaines de milliers de personnes, des récits relatifs à des refus d’accréditation ont commencé à émerger ces dernières semaines. Il en ressort que la principale cause potentielle de la mise à l’écart de certaines personnes réside dans leur activité militante, à l’instar de Léon, intermittent du spectacle dont le témoignage a été publié par Mediapart. Nous avons donc lancé un appel à témoignages, et ceux-ci se sont avérés nombreux. En voici quelques-uns (tous les prénoms ont été modifiés).
Jeanne est secouriste bénévole et l’association dont elle fait partie a été sollicitée pour les JO. Jeanne s’est donc proposée pour se mobiliser une semaine. En parallèle, elle milite contre le dérèglement climatique depuis plusieurs années et a notamment participé à différentes actions de désobéissance civile au cours desquelles elle s’est fait arrêter par la police, sans jamais être poursuivie ni condamnée. Début juin, le président de l’antenne locale de son association de secourisme a reçu une lettre de refus de l’organisation des JO. Elle ne pourra pas exercer comme secouriste durant les JO, malgré la demande.
Marc est salarié d’un opérateur de transport et devait travailler pendant les JO pour les dépôts de bus des accrédités et athlètes. Mais Marc fait partie d’Extinction Rebellion. Il a été contrôlé en manifestation et a participé à des actions de désobéissance civile, ce qui l’a mené à être arrêté et gardé à vue deux fois. Il est le seul des 300 personnes de son employeur mobilisées sur ces sites à s’être vu refuser son accréditation.
Simon devait travailler pour l’accueil du public dans un stade où il y a des épreuves des JO. Il avait déjà reçu son emploi du temps lorsqu’il a reçu son refus d’accréditation le 12 juillet dernier. Par le passé, il a été reconnu coupable pour entrave à la circulation dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, mais a été dispensé de peine. Il milite également au sein d’Extinction Rebellion et des Soulèvements de la Terre.
Juliette est une militante qui a subi quelques gardes à vue dans le cadre de manifestations. Poursuivie une fois, elle a été relaxée avec un stage de citoyenneté. Elle devait être bénévole en secourisme, mais n’a jamais reçu son autorisation, quand le reste des membres de son association l’ont eue.
Mathieu travaille depuis plusieurs années pour une chaîne de télévision comme opérateur de prise de vue. Il a milité pendant plus d’une dizaine d’années dans des associations de chômeurs avec lesquelles il a fait des actions d’occupation, ce qui l’a conduit à des interpellations et des gardes à vue il y a plus de 10 ans. Plus récemment, en 2020, il a été envoyé par une chaîne afin de filmer les militant·es d’Alternatiba lors de l’envahissement du tarmac de Roissy. Il a été arrêté avec elles et eux, et malgré sa lettre de mission et l’intervention de l’avocat de la chaîne, il a fait 12 heures de garde à vue. Depuis 2023, il se voit désormais refuser l’entrée des ministères au sein desquels il doit filmer, alors qu’il l’a fait pendant 20 ans. Pour les JO, il reçoit le même traitement de faveur : un avis défavorable du SNEAS qui l’empêche d’accéder au Paris Media Center. Même si son employeur est compréhensif, il est néanmoins beaucoup moins appelé qu’auparavant pour des missions de travail.
Camille devait travailler pendant les Jeux et animer des visites pour les touristes, via un opérateur affilié à Paris 2024. Elle participe à des activités de désobéissance civile depuis une petite année. Son identité a été relevée par les policiers au cours d’une de ces actions. Son nom a aussi été utilisé pour déclarer une manifestation dénonçant les violences sexistes et sexuelles devant une école de commerce, où étaient présents des agents des renseignements territoriaux. Elle a été prévenue la dernière semaine de juin qu’elle ne pourrait pas travailler pendant les JO. Elle n’a jamais obtenu de réponse de la part de l’adresse mail indiquée à laquelle elle a écrit pour contester.
Thomas, professionnel de l’audiovisuel, avait obtenu un contrat pour participer à la réalisation des Jeux afin d’opérer une prestation technique complexe. Début juillet, il est extrêmement surpris quand il reçoit un refus d’accréditation. Il n’a jamais eu aucune interaction avec la police à part pour une altercation en voiture, il y a longtemps. Il évolue dans un cercle amical militant et a participé il y a quelques années à des actions et réunions d’Extinction Rebellion, sans en avoir été organisateur. Il soupçonne donc être dans un fichier de renseignement.
Loris travaille pour l’hôtel de luxe du Collectionneur, dans lequel le comité international olympique réside pour les JO. Loris est délégué Syndical CGT et participe aux négociations annuelles qui ont lieu en ce moment. Mais il ne peut plus se rendre à l’hôtel – et donc négocier – depuis qu’il a reçu un avis négatif du SNEAS. Par le passé, il avait été interpellé et contrôlé par la police dans le cadre de sa participation à la défense de la cause arménienne. La CGT a publié un communiqué dénonçant cette situation inédite.
Théo, intermittent du spectacle, devait effectuer une mission de dix jours en tant que technicien afin d’installer les systèmes de sonorisation de la cérémonie d’ouverture. Il ne fait pas partie d’une association en particulier, mais a participé à un certain nombre de manifestations. Il a été interpellé l’année dernière lors des arrestations massives ayant eu lieu pendant le mouvement contre la réforme des retraites. Il est ressorti sans poursuite, mais il n’a pas pu travailler, faute d’avis favorable. Une situation très proche de celle d’Elie, également technicien son. Pour sa part, il avait fait une garde à vue après une manifestation étudiante le lendemain de l’annonce du recours au 49-3. Elie a aussi pu être arrêté – sans poursuite – au cours de free parties.
Une criminalisation aux conséquences concrètes
Au regard des situations décrites ci-dessus, il semble très probable que le SNEAS ait eu pour consigne d’écarter toute les personnes ayant un lien avec des actions militantes, sans une quelconque forme de nuance. La plupart d’entre elles se sont vu notifier abruptement cette décision, sans aucun moyen de la contester ou de faire un recours. Pour toutes ces personnes – et toutes les autres qui seraient concernées – un tel refus signifie faire une croix sur une mission, sur une activité souhaitée, et pour la majorité sur de l’argent sur lequel elles comptaient pour vivre. C’est aussi devoir se justifier et dévoiler sa vie privée à la structure qui les emploie ou celle où elles exercent, pour expliquer un tel avis défavorable, et risquer d’autres conséquences futures. Enfin, c’est comprendre qu’elles se retrouvent « marquées » comme de potentiel·les délinquant·es ou en tout cas comme une source de risques pour la sécurité.
Surtout, ces témoignages dévoilent non seulement l’ampleur de l’édifice de fichage qui s’est construit petit à petit mais également les potentielles applications concrètes de discrimination à une échelle importante. Couplée aux mécanismes « d’exception » développés en réaction aux attentats des années 2010 – dont les « grands évènements » font partie – cette accumulation d’information sur la population permet de façon bien concrète d’écarter des personnes de la société, en tant qu’« ennemis d’État ».
Au sein de La Quadrature du Net, nous avons connaissance de ces dispositifs, nous en suivons les terribles évolutions et nous en documentons les risques de potentielles utilisations liberticides. Ici c’est une application massive et plus que dangereuse qui s’est concrétisée au prétexte de sécuriser les Jeux Olympiques. Le système tentaculaire du contrôle policier et de la multiplication des fichiers de police montre une nouvelle efficacité : être en capacité – à très grande échelle – d’exclure, isoler, contraindre des individus et de les priver de leurs libertés en dehors de tout cadre judiciaire et par des décisions administratives arbitraires. Cela peut se faire en dehors de toute condamnation passée ou dans une forme de « double peine » possible à vie pour des condamnations pourtant très limitées. Loin de toute mesure supposément « ciblée » – comme le gouvernement aime le laisser entendre – il s’agit bel et bien d’une surveillance massive de la population sur laquelle est opérée un tri arbitraire et politique.
Cette discrimination politique s’accompagne de la répression et de l’invisibilisation de toute forme de critique des Jeux Olympiques. Des personnes ont été assignées à résidence, des manifestations ont été interdites sur le parcours de la flamme, des militant·es ont été arrêté·es notamment pour avoir collé des stickers dans le métro ou ont été considéré·es comme saboteurices pour des bottes de paille, tandis que des journalistes ont été placés en garde à vue pour avoir couvert une visite symbolique des dégâts causés par les Jeux en Seine-Saint-Denis, organisée par Saccage 2024. Cette répression inquiétante s’inscrit dans la continuité des discours et des volontés politiques visant à criminaliser toute forme d’activisme.
En régime représentatif, la critique du pouvoir et de ses institutions par des actions militantes est la condition de tout réel processus démocratique. Pourtant, en France, les formes de contestation – chaque jour plus essentielles au regard des urgences liées au dérèglement climatique et à la résurgence forte des idées racistes – sont de plus en plus réprimées, quels que soient leurs modes d’expression (manifestation, désobéissance civile, blocage, expression sur les réseaux sociaux…). Cette modification rapide et brutale de la manière dont sont perçues et bloquées des actions de contestation, qui étaient depuis toujours tolérées et même écoutées par les pouvoirs publics, renverse l’équilibre voulu en démocratie. Quand tout le monde ou presque peut être considéré comme une menace potentielle, quand on doit questionner ses opinions politiques pour obtenir un emploi, quand il apparaît acceptable que l’État en sache toujours plus sur sa population au nom d’un risque pour la sécurité qui est présenté comme permanent et impérieux, comment se prétendre encore du camp démocratique ?
Malgré une machine répressive lancée à pleine vitesse, malgré l’inquiétude légitime, il est néanmoins toujours plus urgent et crucial de continuer à militer, de continuer à organiser des actions pour se faire entendre. Cela demeure la meilleure méthode pour dénoncer les abus de pouvoirs et les dérives liberticides aujourd’hui amplifiées au nom de « l’esprit olympique ».
References
| ↑1 | Voir la Délibération CNIL n°2019-06, 11 juillet 2019, portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n°2017- 1224 du 3 août 2017 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données » (ACCReD), accessible ici |
| ↑2 | Voir la liste complète à l’article R.211-32 du code de la sécurité intérieure |
| ↑3 | Didier Paris, Pierre Morel-À-L’Huissier, Rapport d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité, 17 octobre 2018, page 58, URL : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1335_rapport-information.pdf |
| ↑4 | L’ article 1er du décret n°2007-914 du 15 mai 2007 liste l’ensemble des fichiers de renseignement qui ne font pas l’objet de publication |